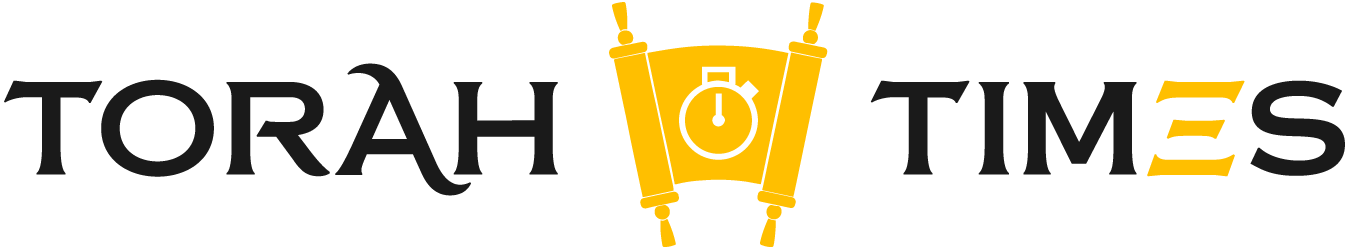Il s’appelle Yehouda Bensoussan. Il naquit dans les années 1930 au Maroc, à Meknès, et il y connut cette vie chaleureuse, vibrante d’attachement au judaïsme qui caractérisait la communauté locale. Son père était un des commerçants importants de la ville et, à ce titre, un de ses notables. Ses affaires l’occupaient largement mais il trouvait toujours du temps pour les choses importantes car pour lui, le judaïsme était peut-être la plus grande « affaire » de sa vie. Chaque soir, malgré sa fatigue réelle, il réunissait ses enfants pour étudier au moins quelques versets avec eux et le Chabbat y était entièrement consacré, en dehors des repas du jour où de nombreux invités étaient toujours présents et où l’atmosphère semblait imprégnée d’une sainteté particulière. Yehouda Bensoussan eut ainsi le bonheur de ressentir, pendant toute son enfance, une foi presque tangible, de la vivre comme une donnée indissociable de l’existence. Jusqu’à 16 ans, Yehouda étudia à la Yéchiva « Kéter Torah », aussi bien les matières profanes que les textes du judaïsme. Mais le commerce l’attirait. Il interrompit donc ses études et commença à travailler auprès de son père, désireux de montrer, le plus tôt possible, l’étendue de ses dons. Cela ne le détourna pas de la voie dans laquelle il avait été éduqué et il continua d’être fidèle à la pratique des commandements les plus importants du judaïsme.
C’est à cette époque qu’arriva, envoyé dans la ville par le Rabbi, Rav Michaël Lipsker. Il y ouvrit immédiatement une école, organisa des activités pour les enfants et tout Meknès sut très vite apprécier le prix de tels efforts. De plus, il créa une institution appelée « Tiférèt Bahourim », destinée aux jeunes hommes qui avaient cessé leurs études et travaillaient. C’est ainsi que toute une génération put renforcer son lien avec la connaissance juive et avoir, pour la première fois, contact avec le monde ‘hassidique. Yehouda y trouva naturellement sa place. Mais les jours, les mois et les années passèrent et, arrivé à 24 ans, il se maria. Il partit vivre à Casablanca pendant plusieurs années avant de revenir à Meknès. Par la nature des choses, ses liens avec Rav Lipsker se détendirent puis cessèrent peu à peu, ses affaires étaient devenues trop prenantes. Réussite professionnelle, personnelle, mariage exemplaire, vie juive pleine, Yehouda était un homme heureux. Mais, dans le secret de son cœur, une chose lui manquait : son couple n’avait pas d’enfant. Sa femme et lui en ressentirent le manque avec une force croissante d’année en année. Dix ans passèrent ainsi et les époux Bensoussan commencèrent à désespérer : trouveraient-ils un jour un sens à leur vie ?
Un jour, Yehouda se rendit à Paris pour ses affaires, comme il le faisait souvent. Il alla rendre visite à un de ses amis proches, commerçant juif comme lui. Il le trouva dans son bureau, manifestement en proie à une profonde émotion, une joie immense se peignant sur son visage. Yehouda s’en rendit facilement compte et il interrogea : « Qu’y a-t-il ? » L’ami lui répondit : « Une grande nouvelle ! J’ai un fils marié depuis dix ans et il n’avait jamais pu avoir d’enfant. Aujourd’hui, il vient d’avoir un petit garçon ! » Yehouda le félicita sincèrement mais l’ami, toujours ému, continua : « C’est un vrai miracle ! Et sais-tu qui l’a fait ? Le Rabbi de Loubavitch ! Mon fils a un ami qui s’est rapproché des Loubavitch. Il lui a conseillé de demander une bénédiction au Rabbi, cela fait un an. Regarde ! La bénédiction s’est réalisée ! » Yehouda avait été vraiment heureux pour le fils de son ami mais il ne parvint pas à se contenir davantage : des larmes se mirent à couler de ses yeux sans qu’il puisse les arrêter. Son ami comprit. Il était désolé de ce qu’il avait causé. Il prit les mains de Yehouda, les serra comme s’il avait voulu transmettre force ou confiance et il dit : « Pardonne-moi d’avoir oublié tes sentiments dans ma joie. Ecoute-moi, tu es mon ami. Je ne suis pas un ‘hassid et même pas religieux. Laisse-moi te donner un conseil : écris au Rabbi ! » Pour Yehouda, cette idée n’était pas étrangère. Elle lui rappelait sa jeunesse, Rav Lipsker. Il répondit à son ami qu’il le ferait sans tarder, qu’il ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas écrit de lui-même précédemment. Il téléphona au fils qui le présenta au délégué du Rabbi en Ile-de-France, Rav Chmouel Azimov. Celui-ci lui donna les renseignements demandés et lui indiqua : « Quand on écrit au Rabbi, il faut décider d’accepter les conseils qu’il donnera et renforcer sa pratique du judaïsme. » Yehouda écrivit… et les semaines passèrent. En fait, Yehouda commençait déjà à oublier sa démarche quand, un jour, sa femme lui apprit : « Il y a du nouveau… » Un an après l’envoi de la lettre, les Bensoussan eurent enfin le bonheur de voir naître une fille qu’ils appelèrent Mazal Batia.
Il n’est pas nécessaire de décrire la joie qui transfigura la maison dès que l’enfant y prit sa place. Très vite, il en devint le centre. Les Bensoussan avait tant attendu cet événement qu’ils ne purent y voir qu’à la fois leur raison d’être et le couronnement de leur vie. Puis Mazal Batia eut trois ans, l’âge de penser au début de son éducation. C’est alors que les Bensoussan s’interrogèrent. Le Maroc avait beaucoup changé depuis l’enfance de Yehouda. Nombreux étaient les Juifs qui avaient quitté le pays et la communauté s’était beaucoup réduite. Par ailleurs, on était juste après la guerre de Kippour et l’ambiance, dans la rue, était parfois tendue. Ils pensèrent à leur fille et, comme d’autres avant eux, ils se dirent que le temps était venu de s’installer en Israël. Une fois prise la décision de principe, il restait à la mettre en œuvre et ce n’était pas chose facile. Yehouda avait des affaires importantes au Maroc, il fallait donc trouver le moyen de transférer ses avoirs en Israël. Il devait aussi découvrir dans quoi il pourrait investir dans son nouveau pays. Il noua des contacts, fit des prévisions, planifia et finit par préparer suffisamment son installation. C’est ainsi qu’en 1974, la famille Bensoussan réalisa son rêve. Tout n’alla pas sans difficultés mais ils surent qu’ils avaient fait le bon choix quand Mazal Batia commença à fréquenter l’école et manifesta sa joie. Trois ans et demi passèrent et les Bensoussan n’eurent jamais à regretter leur décision. Un jour, leur fille rentra à la maison de l’école en se plaignant de violents maux de tête. La mère ne s’inquiéta pas outre mesure, Mazal Batia avait eu la veille une journée d’activités fatigante. Elle lui donna donc un calmant léger pour apaiser cette brusque migraine. Devant la persistance de la douleur, deux jours plus tard, ils l’emmenèrent chez le médecin de famille qui prescrivit un antibiotique. De fait, les maux de tête disparurent et les Bensoussan oublièrent vite l’incident. Une semaine passa et la douleur réapparut, presque insupportable. Cette fois, les Bensoussan allèrent consulter un professeur reconnu qui, après examen, leur demanda une série d’analyses à pratiquer à l’hôpital et leur obtint en urgence un rendez-vous pour le surlendemain. Les résultats lui furent remis le jour suivant ; il appela immédiatement les Bensoussan : « Venez à mon cabinet », dit-il, « c’est urgent. » Yehouda eut une sorte de mauvais pressentiment, qu’il écarta à l’instant même ; après tout, ce n’était qu’une migraine. Il choisit, cependant, de ne pas perdre de temps.
Lorsqu’il entra dans le cabinet, il y trouva, avec le professeur consulté, le médecin de famille. Tous deux le regardaient l’air grave. Yehouda eut cette sensation incontrôlable d’une catastrophe imminente. Le médecin de famille bredouilla quelques mots de courtoisie puis il se résolut à parler : « Les examens montrent que votre fille a une tumeur au cerveau ! » En un instant, le monde cessa d’exister pour Yehouda, comme si une obscurité brutale l’avait tout à coup recouvert. Ne renonçant à aucun moment à lutter, il interrogea : « Qu’allez-vous faire ? Quelles chances de guérison y a-t-il ? » Que peut-on répondre à un père à la recherche du plus petit espoir possible ? Les médecins lui répondirent avec toute la douceur qu’ils purent mais avec lucidité : « La situation est grave, il n’y a pas beaucoup de chances. Un conseil, malgré tout : si on peut faire quelque chose, c’est aux Etats-Unis, c’est le seul endroit. » Yehouda retourna à son bureau et téléphona à un ami médecin à Paris. Il le connaissait depuis son enfance, c’était, comme lui, un Juif marocain, il était professeur de médecine ; Yehouda avait toute confiance en lui. Il lui parla, lui raconta toute l’histoire. L’ami prit les coordonnées des médecins israéliens et, vingt minutes plus tard, rappela Yehouda. Sa conclusion était claire : la situation était effectivement très grave et il fallait partir pour les Etats-Unis ; lui-même s’offrait à les accompagner, il avait des contacts utiles dans certains hôpitaux américains. C’est ainsi qu’une semaine plus tard, la famille Bensoussan, accompagnée de l’ami médecin, fit admettre Mazal Batia dans un hôpital de Boston et s’installa dans un hôtel voisin.
Les examens recommencèrent, cela dura des jours. Puis le chef du service convoqua Yehouda. « Voici nos conclusions », dit-il, « il y a une divergence dans l’équipe médicale pour le cas de votre fille : faut-il opérer on non et, sinon, quel traitement choisir ? Chacune des solutions présente un espoir mais aussi de nombreux risques. Les chances de réussite d’une opération ne sont pas grandes et il y a un risque de dommages irréparables. » « Et si on n’opère pas ? » demanda Yehouda. « Au maximum six mois de vie » fut la réponse. Il retourna à son hôtel. La décision lui appartenait et elle n’était pas facile à prendre. Yehouda rapporta tout à sa femme et ils restèrent assis sans parler dans leur chambre : que devaient-ils faire ? Tout à coup, la femme brisa le silence : « Tu dois aller chez le Rabbi de Loubavitch ! C’est lui qui nous a donné notre fille, lui seul peut la sauver ! » dit-elle. Yehouda appela un parent qui habitait New York et lui demanda de prendre rendez-vous avec le Rabbi pour lui. Cela ne tarda pas : rendez-vous fut pris pour le surlendemain à minuit. Et Yehouda se présenta chez le Rabbi, bouleversé. Il attendit son tour une demi-heure, déversant tout son cœur dans la lecture des psaumes. Puis ce fut à lui, il entra dans le bureau du Rabbi. Il lui donna la lettre qu’il avait préparée et il sentit la douleur monter en lui, incontrôlable : il éclata en sanglots. Au milieu de ses larmes, il vit le Rabbi, dont les yeux pénétrants le transperçaient, faire un sourire lumineux. Il l’entendit dire, presque comme dans un rêve : « Le Talmud dit : ‘Quand commence le mois de Adar, on multiplie la joie !’ Et vous entrez dans mon bureau pour faire le contraire de la joie ?! M’avez-vous demandé l’autorisation de faire entrer la tristesse dans la pièce ? » Yehouda ne sut pas comment accueillir cette apostrophe. Il était venu parce que la vie de sa fille était en jeu et le Rabbi plaisantait avec lui ? Les mots explosèrent dans sa bouche : « Rabbi, c’est la vie de ma fille ! » et sa voix se brisa en sanglots. Le Rabbi le regarda encore et lui dit : « Et vous voulez sauver la vie de votre fille en faisant entrer la tristesse dans le bureau au mois de Adar ?! » Cette fois, Yehouda perçut que quelque chose se cachait derrière les mots du Rabbi, qu’il ne s’agissait pas d’une simple plaisanterie. Il dit : « Je suis prêt à être joyeux à l’instant même mais comment puis-je le faire ? » « Adar est le mois de la joie », affirma le Rabbi, « car c’est celui où ‘ce fut inversé’, tout se transforma ! » Puis il plaça ses mains au-dessus de son bureau et, brusquement, il les retourna en criant avec force, et en français, « Inversé ! Tout se transforma ! » Alors le Rabbi regarda Yehouda et ajouta : « Nous entendrons des bonnes nouvelles. » L’entrevue était terminée, Yehouda, sans vraiment savoir ce qu’il faisait, sortit du bureau. C’est là, dans le hall d’entrée, qu’il reprit ses esprits et s’effondra : il avait oublié de questionner sur l’essentiel. Il ne savait toujours pas s’il fallait ou non opérer sa fille ! Le Rabi n’en avait rien dit. Il se précipita sur Rav Groner, le secrétaire du Rabbi qui veillait au bon ordre des choses, et le supplia : « Il faut que j’entre à nouveau dans le bureau ! » Rav Groner ne lui laissa aucun espoir. De fait, la file d’attente était longue et il ne pouvait en être question. Yehouda insista, désespéré. Rav Groner lui expliqua qu’il comprenait sa détresse et qu’il avait encore une solution : qu’il mette sa question par écrit et lui-même la transmettrait dès que possible. Yehouda fit observer qu’il avait déjà remis une lettre au Rabbi en entrant dans le bureau, avec cette même interrogation restée sans réponse. Rav Groner lui recommanda cependant de réécrire et ainsi fit-il. Le lendemain soir, Yehouda était de retour dans son hôtel à Boston, un message urgent l’attendait : rappeler Rav Groner. Il s’empressa de le faire et celui-ci lui dit : « Ecoutez, je ne sais pas ce que le Rabbi vous a dit dans le bureau mais, sur la lettre que vous avez écrite, le Rabbi a noté : ‘Je lui ai déjà répondu hier quand je l’ai reçu’. »
Yehouda ne sut que faire. Il ne se souvenait pas que le Rabbi lui ait dit quelque chose de précis, il n’avait pas pu reposer la question directement et il n’avait reçu aucune réponse à la lettre remise. Il rappela Rav Groner et lui demanda : « Peut-être le Rabbi fait-il référence au fait qu’il m’ait dit ‘Inversé, tout se transforma’ ? » Le secrétaire répondit que cela pouvait parfaitement être le cas, cependant Yehouda avait besoin de plus d’assurance. Il supplia qu’on remette, de sa part, une nouvelle lettre au Rabbi le priant de donner une réponse claire. Dès le lendemain, Rav Groner appela Yehouda et lui transmit la réponse souhaitée : « S’il veut vraiment demander , alors la réponse est de consulter un troisième médecin, qui soit un médecin ami, et de faire selon son avis. » Yehouda s’inquiéta du sens de cette phrase étrange « S’il veut vraiment demander… », peut-être la dernière lettre était-elle en trop ? En tous cas, la réponse était là et Yehouda l’appliqua. Il prit contact avec un ami médecin en France, à Lyon. Celui-ci recommanda l’opération et cet avis fut transmis à l’hôpital bostonien. La date de l’opération fut immédiatement arrêtée : cinq jours plus tard, deux jours après la fête de Pourim. Les Bensoussan n’avaient plus rien à faire que de prier et de soutenir leur fille. Entretemps, l’équipe médicale fit tous les préparatifs nécessaires, de nouveaux examens, de nouvelles analyses. Ils parlèrent longuement aux parents : il y avait de vraies chances mais les risques étaient élevés.
Le jour de l’opération arriva. C’est le matin, à 8 h 30 que Mazal Batia entra dans le bloc opératoire et que ses parents prirent place dans la salle d’attente. Ces derniers le savaient : l’opération était prévue pour durer sept heures et ces heures-là allaient être les plus difficiles de leur vie. Une heure s’écoula avec une lenteur désespérante. Tout à coup, la porte de la salle d’attente s’ouvrit et, sur le seuil, apparurent le chirurgien, deux autres médecins, une infirmière. Les Bensoussan pensèrent… La femme se mit à sangloter, le pire s’était donc produit ? Il leur fallut une à deux minutes pour comprendre. Le chirurgien tentait de leur dire quelque chose : « Un phénomène incroyable ! Nous ne pouvons pas l’expliquer ! Nous avons ouvert la tête, il n’y a aucune tumeur ! » Yehouda et sa femme restèrent sans réaction, ne parvenant pas encore à saisir la portée de ce qu’ils apprenaient. Il leur fallut une bonne heure pour retrouver leurs moyens. Le chirurgien les attendait, ils le trouvèrent entouré de toute son équipe. Ils les accueillit d’un : « C’est impossible ! Il n’y a aucune explication ! Nous venons de revérifier les radios, tous les examens, la tumeur était bien là ! Et elle a disparu ! » Yehouda, qui ne cherchait pas à cacher son émotion, répondit : « Nous, nous avons une explication, le Rabbi a dit ‘c’est le mois où tout se transforma’. » Et il ajouta : « Quand pourrons-nous voir notre fille ? » « Quelques heures, peut-être un peu plus, le temps qu’elle se remette complètement de son anesthésie » leur fut-il répondu. Leur joie était immense, avec leur sentiment de reconnaissance pour ce qu’ils étaient bien obligés de qualifier de « miracle ». Ils ne savaient pas encore que leur épreuve n’était pas terminée.
La journée passa puis la nuit puis encore une matinée et les Bensoussan se heurtaient toujours à la même réponse : « Elle a encore besoin de se reposer. » L’inquiétude qu’ils connaissaient depuis si longtemps commença à réapparaître. Ils forcèrent l’entrée du bureau du chef de service. « Qu’arrive-t-il à notre fille ? » exigèrent-ils de savoir. Ils apprirent la nouvelle de la bouche du chirurgien : « Il y a un problème. Votre fille n’a pas repris conscience. » La voix tremblante, Yehouda interrogea : « C’est dû à l’opération ? » « C’est très possible » répondit le médecin. « Et combien de temps cela durera-t-il ? » poursuivit Yehouda. « Le médecin dit avec prudence : « Nous ne savons pas. Peut-être un jour, peut-être deux, peut-être est-ce irréversible… » C’était plus que les Bensoussan n’en pouvaient supporter. Yehouda dit à sa femme : « Je prends le premier avion pour New York, je vais chez le Rabbi. Toi, reste auprès de notre fille ! » Quatre heures plus tard, à New York, Yehouda suppliait le secrétaire de lui permettre de voir le Rabbi et lui parler en urgence. La réponse fut définitive : « C’est impossible ! » « C’est la vie de ma fille ! » implora Yehouda. « Ecrivez une lettre, je la donnerai immédiatement ! » proposa le secrétaire. Il n’y avait pas le choix, Yehouda écrivit et il laissa parler son âme : « Nous n’avons plus la force pour cela. Nous avons vu le miracle du Rabbi. Alors pourquoi cette nouvelle épreuve ?… » Il donna sa lettre au secrétaire et il lui déclara : « Je ne sortirai pas du secrétariat sans la réponse et la bénédiction du Rabbi ! » Cinq minutes plus tard, le secrétaire avait une réponse, Yehouda l’a gardée jusqu’à ce jour : « Je le rappellerai sur le tombeau du Rabbi précédent pour une guérison complète et on annoncera des bonnes nouvelles. Et se réalisera en eux ‘le mois qui a été transformé d’angoisse en joie… et ils reçurent ce que Mordé’haï avait écrit sur eux’. » Avant de reprendre le chemin de l’aéroport, Yehouda appela sa femme pour lui raconter ce qui s’était passé. Le personnel de l’hôpital ne put pas la trouver immédiatement et Yehouda dut attendre au bout du fil un quart d’heure, se demandant ce que ce retard cachait encore. Enfin, elle prit l’appareil mais Yehouda n’eut pas le temps de parler. Sa femme lui dit, pleurant d’émotion : « Viens vite ! Notre fille s’est réveillée il y a un quart d’heure ! » « Le miracle s’est produit… » pensa Yehouda, cependant il n’était pas complet. L’enfant avait bien repris conscience mais elle parlait avec difficulté et, parfois, elle souffrait de troubles de mémoire. Les médecins firent tout ce qu’ils pouvaient mais ce fut en vain. Yehouda demanda de nouveaux examens, ils se révélèrent sans autre résultat que de fatiguer l’enfant. Une semaine avant la fête de Pessa’h, les Bensoussan quittèrent enfin l’hôpital avec la promesse des médecins que leur fille parviendrait à surmonter le dernier problème restant, « le temps fera son œuvre » dirent-ils.
C’est à New York, chez son parent, qu’ils décidèrent de passer la fête. Yehouda se souvenait de son enfance au Maroc. Il savait que la coutume Loubavitch veut que l’on célèbre, dans l’après-midi du dernier jour de la fête, la « Séoudat Machia’h », le banquet de Machia’h. Il dit à son parent qu’il souhaiterait participer à cette célébration qui devait avoir lieu chez le Rabbi. Son hôte l’y accompagna et c’est ainsi que Yehouda s’installa pour vivre l’événement. Yehouda ne comprenait pas ce que disait le Rabbi, ses commentaires, mais il vécut la joie, la chaleur, l’enthousiasme, il chanta avec toute l’assemblée et, à plusieurs reprises, comme beaucoup, il tendit son verre et dit « Lé’haïm » au Rabbi. Cela avait déjà duré quelques heures lorsque, pendant une des interruptions consacrées au chant, il vit que tous le regardaient. Le ‘hassid assis à côté de lui, lui donna un léger coup de coude et lui montra : « Le Rabbi vous demande d’aller à lui. » C’est alors que Yehouda s’en rendit compte : le Rabbi le regardait et, de la main, lui faisait signe d’approcher. Très ému, tremblant, Yehouda s’avança. Le Rabbi lui donna deux petits morceaux de Matsa et lui dit : « La Matsa est ‘l’aliment de la foi et l’aliment de la guérison’. Vous donnerez ce morceau à votre fille pour que ce soit pour elle l’aliment de la guérison. Et ce morceau, vous le mangerez pour que ce soit pour vous l’aliment de la foi. Votre fille ne doit pas souffrir parce que, chez vous, il manque de la foi. » Si Yehouda avait vécu beaucoup d’émotions jusqu’ici, celle-ci le laissa tremblant. Il reprit rapidement sa place. A la fin de la célébration, comme de coutume, le Rabbi distribua à chacun un peu de vin. Yehouda, imitant les autres participants, s’approcha pour en recevoir. En le voyant, le Rabbi sourit et lui dit : « Aujourd’hui, c’est la Mimouna chez les Juifs marocains, c’est un jour de foi, et, la semaine prochaine, commence le ‘mois de la guérison’ car son nom en hébreu, Iyar, est l’acrostiche du verset ‘car Je suis D.ieu Qui te guérit’ – que se renforcent chez vous la foi et, chez votre fille, la guérison. Mais, comme je vous l’ai dit auparavant, que la guérison de votre fille n’attende pas que se renforce votre foi… »
A ce jour, Yehouda ne sait toujours pas ce qui survint en premier, son acquisition de la foi ou la guérison de sa fille. En tout état de cause, depuis ce jour, Mazal Batia ne connut plus aucun trouble de la parole ou de la mémoire. Les années ont passé et, aujourd’hui, elle est mariée et mère de famille. Son premier fils porte le nom de Mena’hem Mendel. Et, chaque année, quand la famille fête la Mimouna, elle y célèbre aussi la foi et la guérison.